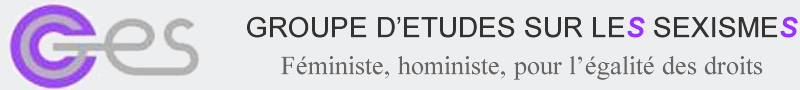Dénonciation calomnieuse : procédure, prescription et peines encourues. Léa Boluze, Capital, 12 août 2025
25 août 2025 //Capital
Par Léa Boluze, Rédactrice web
Publié le 12 août 2025 à 10h42.
Dénonciation calomnieuse : procédure, prescription et peines encourues
La dénonciation calomnieuse consiste à dénoncer le prétendu auteur d’un fait que l’on sait inexact ou inventé. Elle constitue une atteinte à l’honneur sanctionnable par la loi. Comment porter plainte en cas de dénonciation calomnieuse ? Existe-t-il des délais de prescription à respecter ? Quelles preuves faut-il fournir ? Explications !
C’est quoi une dénonciation calomnieuse ?
Dénonciation calomnieuse : définition du Code pénal (article 226-10)
Selon le premier alinéa de l’article 226-10 du Code pénal, elle correspond à la « dénonciation d’un fait […] contre une personne déterminée, qui est de nature à entraîner des sanctions […] et que l’on sait totalement ou partiellement inexact ».
Puis : « La fausseté du fait dénoncé résulte de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n’a pas été commis ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée. »
Caractéristiques de la dénonciation calomnieuse
Ainsi, une dénonciation calomnieuse est le fait d’accuser une personne à tort d’un acte qu’elle n’a pas commis, en sachant que l’accusation est fausse. En d’autres termes, il s’agit de l’acte de falsifier une accusation dans le but de nuire à l’honneur, à la réputation ou à la situation d’une personne. Vois les trois éléments constitutifs :
- Fausse accusation : la personne qui dénonce doit être consciente que l’accusation est fausse et qu’elle n’a aucun fondement réel.
- Intention de nuire : l’objectif de cette dénonciation est de porter atteinte à la victime.
- Acte volontaire : l’auteur de la dénonciation calomnieuse agit délibérément, ce qui la distingue de l’erreur de jugement ou de l’inexactitude involontaire.
Exemple : dénonciation calomnieuse au travail
Si une personne dépose une plainte en accusant quelqu’un de vol alors qu’elle sait pertinemment que cette accusation est fausse et qu’elle cherche à nuire à cette personne, cela constitue une dénonciation calomnieuse. Ainsi, si une personne déclare à la police qu’un collègue a volé l’entreprise dans le but de nuire à sa réputation, elle commet une dénonciation calomnieuse.
Quelle est la différence entre diffamation, dénonciation calomnieuse et délation ?
Diffamation, délation et dénonciation calomnieuse sont des notions qui nuisent à une personne, mais qui impliquent des actions différentes.
Principe de la diffamation ou de la calomnie
La diffamation consiste à communiquer de fausses informations à propos d’une personne. L’objectif principal est de nuire à la réputation d’une personne par la diffusion de fausses informations. Cela peut être fait à l’oral ou par écrit et ne nécessite pas une dénonciation auprès des autorités.
Principe de la délation
La délation consiste à dénoncer quelqu’un aux autorités pour des actes répréhensibles, souvent dans un but d’obtenir des récompenses ou de se protéger. Contrairement à la dénonciation calomnieuse, qui implique une fausse accusation, la délation peut parfois concerner des faits réels, mais souvent exagérés ou mal interprétés.
Comment prouver une dénonciation calomnieuse ?
Prouver les éléments constitutifs de la dénonciation calomnieuse
Pour qu’une dénonciation calomnieuse soit sanctionnée, il est nécessaire de prouver plusieurs éléments constitutifs qui composent l’infraction. En résumé, il faut démontrer que l’auteur de la dénonciation a agi de manière délibérée, en portant une accusation fausse, dans l’intention de nuire à la personne désignée.
Des propos calomnieux préjudiciables
Premier élément constitutif : la dénonciation calomnieuse doit d’abord engendrer des sanctions (articles 226-10 à 226-12 du Code pénal) judiciaires, administratives ou disciplinaires. Selon la Cour de cassation, alors que la mauvaise foi est un élément constitutif de l’infraction, la simple constatation du fait que la dénonciation a été réalisée pour nuire à la victime n’est pas suffisante.
Une accusation calomnieuse spontanée et sans preuve
Deuxième élément constitutif : la dénonciation calomnieuse doit être spontanée. L’auteur de cette atteinte à l’honneur d’un tiers doit avoir sciemment pris l’initiative de divulguer des accusations mensongères. Les déclarations enregistrées par les gendarmes dans le cadre d’une enquête préliminaire ne peuvent pas être qualifiées de spontanées.
Une dénonciation mensongère adressée aux forces de l’ordre
Troisième élément constitutif : l’infraction n’est constituée que si la dénonciation calomnieuse a été adressée à un officier de justice ou un officier de police administrative ou judiciaire. La dénonciation calomnieuse peut aussi avoir été adressée à une autorité qui a le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente (médecin, délégué syndical, supérieur, etc.).
Dans le second cas, le délit sera caractérisé, même si l’autorité saisie par l’auteur de la dénonciation calomnieuse n’a pas transmis celle-ci à l’autorité compétente.
Une victime clairement identifiable
Quatrième élément constitutif : la victime de la dénonciation calomnieuse doit être une personne déterminée ou déterminable. Cela signifie que la personne dénoncée a été désignée en des termes permettant sa détermination stricte et exacte, à défaut d’avoir été dénommée précisément.
Que faire en cas de dénonciation mensongère ?
La victime de la dénonciation calomnieuse dispose de plusieurs possibilités pour se défendre, notamment déposer une main courante ou porter plainte si cela ne suffit pas.
Déposer une main courante pour dénonciation mensongère
Pour signaler une dénonciation mensongère sans engager une procédure judiciaire, il est possible de déposer une main courante auprès du commissariat de police ou de la gendarmerie. Une main courante permet de signaler un événement sans qu’il y ait immédiatement de conséquences juridiques, mais elle a le mérite de formaliser l’incident et de conserver une trace officielle.
Déposer une plainte pour dénonciation calomnieuse
Si la dénonciation mensongère a causé un préjudice, porter plainte est une option. La plainte doit être adressée au procureur de la République ou déposée directement auprès des autorités compétentes (police ou gendarmerie). Pour que la plainte soit recevable, il faut prouver que l’accusation était totalement fausse et que la personne qui a dénoncé le savait, mais a agi dans le but de nuire.
Demander des dommages et intérêts
Des dommages-intérêts couvrant l’ensemble du préjudice subi par la victime peuvent, en outre, être demandés au juge. Il faut alors saisir le tribunal civil pour obtenir réparation. Le tribunal pourra accorder une indemnisation selon l’ampleur du préjudice subi, en tenant compte de l’impact sur votre vie personnelle, sociale ou professionnelle.
Comment porter plainte pour dénonciation calomnieuse ?
Porter plainte aux autorités compétentes
Pour porter plainte en cas d’infraction, la victime peut se rendre dans la gendarmerie ou le commissariat de son choix ou adresser directement un courrier de plainte pour calomnie par lettre recommandée au procureur, afin de demander l’ouverture d’une enquête pour dénonciation calomnieuse au juge d’instruction.
Si elle connaît l’auteur de la dénonciation calomnieuse, elle peut alors s’adresser directement au tribunal correctionnel. La dénonciation calomnieuse étant un délit pénal, c’est le tribunal correctionnel du lieu de commission des faits ou le tribunal du lieu de résidence du prévenu qui est compétent.
Démarches pour porter plainte pour dénonciation calomnieuse
Pour déposer une plainte pour dénonciation calomnieuse, il est important de fournir des informations précises et complètes :
- Les coordonnées des deux parties (si connues).
- Une description détaillée des faits qui constituent la dénonciation calomnieuse : expliquer la fausseté de l’accusation et le préjudice engendré par cette dernière.
- Toute preuve (documents, enregistrements, etc.) est importante pour étayer la plainte.
- Toute information sur l’auteur de la dénonciation calomnieuse est aussi utile : nom, coordonnées, etc.
- Si des témoins étaient présents ou ont des informations pertinentes, il faut inclure leurs coordonnées et leur témoignage.
- Enfin, il faut indiquer la volonté d’engager des poursuites pénales contre l’auteur de la dénonciation calomnieuse.
Il est recommandé de consulter un avocat spécialisé en droit pénal pour vous guider tout au long du processus.
Délai de prescription
La prescription de l’action publique pour les délits est de six ans. Mais la cohabitation de deux procédures judiciaires (contre l’auteur et contre la victime) peut engendrer des interruptions ou des suspensions. La dénonciation calomnieuse est une infraction instantanée, ce qui signifie que la prescription court à compter du jour où la dénonciation parvient à l’autorité compétente.
En cas de classement sans suite de la plainte
Si une plainte pour dénonciation calomnieuse est classée sans suite, cela signifie que la justice a jugé que les conditions n’étaient pas remplies pour des poursuites. On dit alors que l’infraction n’est pas caractérisée. Dans ce cas, plusieurs options sont possibles :
- Demander le réexamen de la décision de classement sans suite à condition de fournir de nouveaux éléments.
- Engager une action civile pour demander des dommages et intérêts.
Quelles sont les peines encourues pour un délit de dénonciation calomnieuse ?
Dénonciation calomnieuse : amende et peine de prison
Le délit de dénonciation calomnieuse est un acte grave en droit français, sévèrement puni par la loi. Une personne qui porte de fausses accusations dans le but de nuire à quelqu’un s’expose à des sanctions pénales. Selon l’article 226-10 du Code pénal, la peine encourue pour le délit de dénonciation calomnieuse est de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
Dénonciation calomnieuse : dommages et intérêts et autres sanctions
Les peines peuvent être plus sévères si la dénonciation calomnieuse a entraîné des conséquences particulièrement graves pour la personne accusée, comme un emprisonnement injustifié ou des pertes professionnelles significatives. En outre, le Code pénal prévoit des peines complémentaires :
- L’interdiction d’exercer l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
- L’interdiction d’exercer les droits civiques et civils.
- La diffusion de la décision du juge.
- Etc.
Évolution législative
Depuis 2020, les peines sont renforcées, avec une plus grande prise en compte des cas où les fausses accusations entraînent des conséquences graves pour la victime, comme la perte d’un emploi. En 2023, une jurisprudence a précisé les modalités de la procédure de plainte, augmentant la responsabilité des auteurs en cas de préjudice majeur causé à la victime.