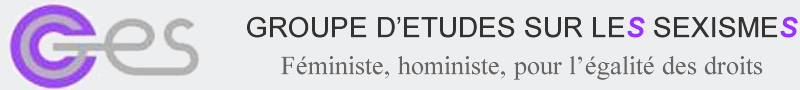Le concept de « féminicide »
7 septembre 2025 //.
Dossier : le concept de «féminicide »
1. Le substantif « féminicide » est usité depuis longtemps, en un sens correspondant à son étymologie
2. Mais le lobby misandre a procédé à une récupération et à un détournement de sens
3. Le « féminicide » (au sens misandre) est un concept manipulatoire
4. Le lobby misandre généralise abusivement l’usage du concept
5. Le lobby misandre milite pour l’inscription juridique du concept, ce qui équivaudrait à une discrimination fondée sur le sexe
6. Enfin, cette généralisation ne peut avoir qu’un effet toxique sur les relations entre les sexes
7. Le GES propose
1. Le substantif « féminicide » est usité depuis longtemps, en un sens correspondant à son étymologie
Etymologiquement, « féminicide » est construit sur les racines latines « femina », qui signifie « femme » et « caedere », qui signifie « tuer » : il signifie donc « action de tuer une femme ». Il est une sous-catégorie de l’ « homicide » (de « homo » = humain et « caedere »), qui signifie « action de tuer un humain ».
On en trouve des occurrences dès le 17e siècle, avec des graphies variées et des acceptions fluctuantes, mais qui renvoient à son étymologie :
– en 1652, la graphie « femmicide » apparaît dans le texte d’une comédie théâtrale de Paul Scarron, Le Jodelet duelliste. Employé dans l’expression « faire femmicide », elle traduit le désir exprimé par un homme de brutaliser une femme.
– en 1853, la graphie « féminicide » est utilisée dans un ouvrage écrit par Alphonse Toussenel, un disciple de Fourier. Sous la forme d’un adjectif, elle renvoie aux violences faites aux femmes.
– le 31 octobre 1887, dans une édition du journal Le Rappel, « féminicide » désigne une femme qui tire au revolver sur une autre femme, avant de retourner l’arme contre elle-même.
– le 17 novembre 1902, la féministe française Hubertine Auclert utilise « féminicide » dans le quotidien Le Radical, pour qualifier une loi portant sur le divorce, qu’elle qualifie de « féminicide ».
La logique de toute langue vivante est la création régulière de néologismes. Il est cependant à remarquer, concernant celui-ci :
– qu’il n’apporte rien au plan sémantique, puisqu’ « homicide » convient déjà pour désigner l’action de tuer une femme ;
– que ses initiateurs n’ont pas eu le souci de créer un substantif symétrique, désignant le meurtre d’un homme, qui pourrait être par exemple « masculinicide », ce qui dénote un certain parti-pris.
2. Mais le lobby misandre a procédé à une récupération et à un détournement de sens
A partir des années 70, l’usage du concept de « féminicide » progresse, mais son acception change, portée par un travail militant. Elle devient, selon les cas, celle d’« un meurtre de femmes commis par des hommes parce qu’elles sont des femmes », ou d’« un meurtre misogyne de femmes par des hommes », ou d’« un meurtre d’une femme, d’une fille, en raison de son sexe ». Cela en fait un crime sexiste, à l’image du crime raciste (crime de haine commis en raison de la perception raciale de la victime par le meurtrier).
La nouvelle acception s’impose progressivement, au fil de étapes suivantes :
– en 1976, au Tribunal international des crimes contre les femmes, à Bruxelles, par la sud-africaine Diana E.H. Russel (1938-2020)
– en 1992, par la publication de Femicide : the politics of woman, de Diana E.H. Russel et la britannique Jill Radford (1947-) / en édition française : Nommer le féminicide
– en 2012, par l’ONU
– le 16 septembre 2014, par la Commission générale de terminologie et de néologie, qui le fait publier au Journal officiel
– en 2015, par le dictionnaire Le Robert. Et en 2019, par le dictionnaire Le Petit Robert qui fait de « féminicide » son « mot de l’année »
– en 2021, par le dictionnaire Larousse.
Parmi toutes les démarches, seule celle de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) inclut dans le « féminicide » les homicides commis par une femme sur une autre femme.
La nouvelle acception déborde l’étymologie. Il ne s’agit plus seulement d’un acte, mais d’un acte porté par une motivation spécifique, la misogynie.
« Féminicide » est devenu un concept idéologique, une arme linguistique dans le combat que mènent le lobby misandre pour stigmatiser « les » hommes comme porteurs d’une criminalité spécifique.
Il est donc nécessaire de distinguer « féminicide » (au sens étymologique ) et « féminicide » (au sens misandre ).
3. Le « féminicide » (au sens misandre) est un concept manipulatoire
Il est incontestable que certains homicides de femmes sont motivés par la misogynie. Ce fut ainsi le cas pour le québécois Marc Lépine, auteur de l’assassinat de 14 femmes à l’Ecole Polytechnique de Montréal le 6 décembre 1989. Outre qu’il avait planifié son acte pour ne faire que des victimes féminines, il avait laissé des écrits le revendiquant clairement comme une protestation contre la féminisation du monde professionnel. Son cas est exceptionnel.
Mais il est impossible d’objectiver une telle motivation en dehors de déclarations venant de l’auteur de l’acte, ce qui est très rare. Certes, il est toujours possible de supposer une motivation inconsciente, mais celle-ci n’est pas non plus objectivable.
En fait, la plupart des homicides de femmes obéissent à de toutes autres motivations. Ainsi, les motivations des homicides conjugaux sont détaillées chaque année depuis 2003 dans l’Etude nationale des violences au sein du couple1. Ces homicides sont principalement la résultante d’une dispute, ou du refus de la séparation. Ils coïncident parfois avec des pertes de contrôle dues à la consommation d’alcool ou de drogues. Dans tous ces cas, c’est une femme qui est visée, et non l’ensemble des femmes. Et il existe aussi des homicides de type « euthanasie ».
Le « féminicide » (au sens misandre) prétend associer un acte donné avec une motivation donnée, toujours la même. Alors que cette motivation n’est pas démontrable. Il relève d’une croyance idéologique.
4. Le lobby misandre généralise abusivement l’usage du concept
Alors que l’ambiguïté du concept devrait les amener à la prudence, de nombreux médias, associations et politiques l’utilisent au contraire systématiquement et abusivement. Il appliquent en l’occurrence une consigne militante.
En 2020, à l’Assemblée nationale, un Rapport d’information sur la reconnaissance du terme de « féminicide », après avoir conclu à l’inutilité d’introduire celui-ci dans le Code pénal, « considère toutefois qu’il convient de développer l’usage de ce terme dans toutes les sphères politiques, médiatiques et institutionnelles, y compris dans les enceintes judiciaires »2.
Et cette consigne est observée. Une enquête de l’association Nous Toutes a étudié le traitement médiatique des « féminicides » entre 2017 et 20223, dans 4 493 articles, en France et à l’international. Ses conclusions : en 2022, il y a 28 fois plus d’articles de presse écrite mentionnant « féminicide/s » qu’en 2017, soit 3211 contre 112. Inversement, les autres mentions (comme « assassinat de femme ») sont stables ou diminuent.
Désormais, tous les homicides de femmes sont qualifiés médiatiquement de féminicides aussitôt qu’ils sont commis, et à peine les enquêtes commencées. Cela relève d’un véritable travail de désinformation.
Les militants misandres savent qu’une progression du concept dans le discours suscitera la même progression dans l’opinion publique. Leur objectif est
– d’établir dans les esprits une distinction absolue entre les homicides de femmes et les homicides d’hommes, comme s’ils étaient de nature différente
– de donner à croire que tous les homicides de femmes sont des « féminicides » (au sens misandre).
5. Le lobby misandre milite pour l’inscription juridique du concept, ce qui équivaudrait à une discrimination fondée sur le sexe
Le crime d’« homicide » figure dès l’origine dans le Code pénal : il désigne l’acte de tuer un humain, quel que soit son sexe. De plus, l’article 132-77 du Code prévoit une circonstance aggravante lorsqu’un crime est commis en fonction du sexe de la victime, ce qui permet de statuer au cas par cas. La loi est donc parfaitement outillée pour lutter contre les homicides de femmes, y compris d’inspiration sexiste.
Pourtant, dans une deuxième étape, des idéologues et des politiques ont commencé de prôner l’inscription du concept dans la loi, et parfois avec succès.
Divers pays ont procédé à l’inscription juridique. En Amérique du sud, le Chili, le Costa Rica, le Guatemala, le Mexique, le Nicaragua, le Pérou, le Salvador .En Europe, Chypre, Malte, la Croatie.
En France, dès les années 2010, diverses associations misandres appellent à l’inscription dans la loi : Fédération nationale solidarité femmes (FNSF), ONU Femmes France, NousToutes, Osez le féminisme (avec une pétition Reconnaissons le féminicide dans la loi, en 2014).
Si cette revendication était satisfaite, elle introduirait dans la loi une discrimination majeure, fondée sur le sexe. Elle affirmerait explicitement que les homicides de femmes sont d’une nature différente de celle de tous les autres homicides, et doivent être traités différemment. Elle affirmerait aussi, implicitement, que les homicides de femmes sont des crimes d’une plus grande gravité que les homicides d’hommes, parce qu’ils sont toujours de nature sexiste. Ce qui entraînerait logiquement des sanctions plus graves.
Si une telle loi excluait du « féminicide » les homicides commis sur des femmes par des femmes, elle introduirait un deuxième niveau de discrimination.
6. Enfin, cette généralisation ne peut avoir qu’une influence toxique sur les relations entre les sexes
La seule statistique officielle disponible est l’Etude nationale sur les morts violentes au sein du couple, réalisée par le Ministère de l’Intérieur. En 2023, elle a comptabilisé 96 homicides de conjointes par leur conjoint ou ex-conjoint. Ce à quoi il faut ajouter quelques homicides hors-couple. Certes, ce nombre est trop élevé et le phénomène doit être combattu par tous les moyens appropriés. Mais, sachant qu’il y a en France environ 35 millions de femmes et 32 millions d’hommes, rien ne permet d’affirmer qu’il s’agit d’un phénomène massif de violence d’un sexe sur l’autre.
La généralisation du concept ne peut avoir qu’un effet toxique sur les relations entre les sexes. Elle favorise artificiellement la croyance de certaines femmes à une volonté d’agression des hommes en général à leur encontre, et la méfiance par rapport à ceux-ci.
7. Le GES propose
Il est impossible d’empêcher la progression d’un néologisme dans la langue. Par contre, il est possible, pour les personnes et les associations désireuses de s’opposer à ce qui s’avère être une dérive sexiste, de s’astreindre à utiliser « homicide » (de femmes ou d’hommes) chaque fois que l’occasion s’en présente. Et, de même, à rappeler l’étymologie et le véritable sens de « féminicide ».
Il est également souhaitable de dénoncer le détournement de sens, et les pratiques des idéologues misandres.Et de militer contre l’introduction du concept dans le code pénal.
Enfin, bien sûr, il faut toujours rappeler que les homicides sont aussi, et dans une proportion non-négligeable, le fait de femmes sur des hommes.
1 Etude nationale des violences au sein du couple, du Ministère de l’intérieur. https://www.interieur.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/etude-nationale-relative-aux-morts-violentes-au-sein-du-couple
2 Rapport d’information sur la reconnaissance de « féminicide, 18 février 2020. https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/ega/l15b2695_rapport-information#_Toc256000020
3 Médias et féminicides : le temps presse. Nous Toutes, novembre 2024. https://www.noustoutes.org/enquetes/#feminicides-temps-presse