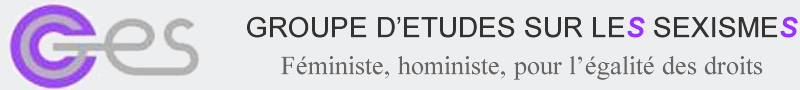Emploi, temps de travail, salaires
22 avril 2025 //.
DOSSIER
.
EMPLOI, TEMPS DE TRAVAIL, SALAIRES
.
1. Dans tous les domaines relatifs au travail, domestique ou social, l’idéologie dominante présente les hommes comme bénéficiant d’une discrimination systémique, au détriment des femmes.
Cette présentation s’appuie sur les affirmations suivantes :
– les hommes en couple consacreraient aux tâches domestiques un temps moindre que leurs conjointes. De ce fait celles-ci seraient astreintes à une « double journée » (travail professionnel + travail domestique).
– les hommes en couple se réserveraient les tâches les plus gratifiantes (bricolage, jardinage, entretien de la voiture), laissant à leurs conjointes le « noyau dur » des tâches domestiques (repas, vaisselle, ménage, linge, etc.).
– les hommes se réserveraient certains métiers, ou du moins, dans les métiers mixisés, les postes de direction. Solidaires entre eux, ils empêcheraient ou retarderaient la promotion des femmes, même après que celles-ci aient démontré leur compétence. Ce que désigne la formule « plafond de verre ».
– les salaires masculins, à postes comparables, seraient en moyenne supérieurs aux salaires féminins.
2. Pourtant, les temps de travail global respectifs des femmes et des hommes sont à peu près équivalent.
Synthétisant l’enquête Emploi du temps de l’INSEE 2009-2010, l’Observatoire des inégalités conclut que le travail domestique quotidien est réalisé, globalement et en moyenne, pour un temps de 3h26 par les conjointes, et pour un temps de 2h par les conjoints, avec un écart qui se resserre progressivement. Comme il s’agit d’une moyenne, on peut aussi considérer que certains conjoints s’y investissent autant voire plus que leurs conjointes.1
L’autre intérêt de l’enquête est qu’elle compare le temps alloué aux tâches domestiques et le temps de travail professionnel. Elle établit ainsi que si le temps domestique quotidien des hommes est inférieur d’1h26 à celui des femmes, leur temps professionnel est, à l’inverse, supérieur d’1h17. Autrement, dit, les travaux respectifs effectués dans le cadre du couple s’équilibrent.
Le concept de « double journée » ne recouvre donc aucune réalité. La première « journée» des hommes est plus longue, leur deuxième « journée » est moins longue. Si l’on additionne les deux « journées », on obtient un résultat à peu près équivalent.
Enfin, comme l’a expliqué le sociologue féministe François de Singly, l’effectuation du travail domestique a une « pluralité de sens ». Les conjointes ne recherchent pas forcément une « égalité » de l’investissement. Certaines recherchent en priorité l’obtention de la reconnaissance de leur conjoint ; ou la satisfaction de manifester leur compétence dans un domaine donné; voire le renforcement de leur identité sexuée de femme2.
3. Dans le travail domestique, la distinction entre travaux gratifiants et travaux pénibles est subjective et non-opératoire.
Le point de vue de l’idéologie dominante sur le travail domestique est imprégné d’une conception purement conflictuelle du couple : la gestion en serait forcément inégalitaire ; les désaccords ne s’y régleraient que dans un rapport de force imposé par le conjoint masculin, et donc favorable à celui-ci ; il ne s’y trouverait aucune possibilité de négociation ni de conciliation.
Dans la réalité, les conjoints se partagent le travail domestique en fonction de leurs ressources, de leur temps disponible, des préférences et des compétences de chacun. Toutes les configurations existent. Dans les couples suffisamment aisés pour employer du personnel domestique, la question de la répartition ne se pose pas. Certains couples attribuent au conjoint la charge de l’entretien de la voiture ou du bricolage sans que celui-ci y trouve de gratification particulière, simplement parce qu’il est le plus compétent. Dans certains couples, le conjoint éprouve une véritable gratification à prendre en charge la cuisine : il l’exerce effectivement, ou à moitié avec sa conjointe… ou la remet à celle-ci parce qu’elle aussi y trouve une gratification. Sans oublier que la participation des enfants, de plus en plus importante à mesure qu’ils grandissent, soulage la tâche des deux conjoints indifféremment.
Bien sûr, il existe des couples où l’un des conjoints (masculin ou féminin) se repose entièrement sur l’autre : ils sont peu nombreux et non-représentatifs de la situation globale.
4. Dans le travail social, il n’existe plus de métiers réservés aux hommes. Par contre, il existe des métiers qui leur sont fermés, ou peu ouverts, ce qui crée une prédiscrimination.
Depuis 1945, le taux d’emploi des femmes (15-64 ans) n’a cessé de progresser. De 2000 à 2022, il a progressé de 64% à 70,7%3. Des secteurs professionnels de bon niveau, antérieurement à majorité masculine sont devenus majoritairement féminins, tels l’enseignement (70,9%)4, la magistrature (66%)5, les relations humaines (66%)6 Même si elles y restent minoritaires, des femmes ont accédé à tous les métiers dont on considérait qu’elles n’étaient pas en mesure de les exercer (policiers, militaires, agents de sécurité, BTP, etc.), chaque année en nombre croissant, et y compris à des postes de direction.
Certains secteurs professionnels sont désormais tellement associés au féminin qu’il est devenu très difficile voire impossible pour un homme d’y entrer ou d’y faire sa place. Il s’agit par exemple de la petite enfance, du secrétariat, de l’accueil, de l’aide aux personnes, de l’aide à l’accouchement. Il y a plusieurs cas de figure :
– certaines formations professionnelles ne sont pas ouvertes aux hommes (c’était le cas de plusieurs formations d’esthétique, mises en cause par le Défenseur des droits7).
– d’autres formations ne présentent aucune perspective d’embauche masculine : secrétariat, accueil, prêt à porter.
– d’autres formations encore n’excluent pas les possibilités d’embauche masculine, mais les jeunes hommes intéressés savent qu’ils se heurteront dans leur exercice professionnel à la suspicion, au doute sur leur compétence, voire au rejet (métiers de la crèche, assistants maternels, éducateurs, sage-femmes). Dans le domaine de la petite enfance, le problème est aggravé par la suspicion de pédophilie, qui, du fait de la surgénéralisation d’actes commis par de réels criminels, pèse désormais sur tous les hommes, et en particulier sur ceux qui souhaitent s’occuper d’enfants.
Même s’ils sont motivés, des hommes renoncent donc à s’engager dans ces formations et s’orientent vers d’autres professions. Il y a discrimination avant l’embauche, ou prédiscrimination.
5. La discrimination à l’embauche s’exerce désormais surtout contre les hommes
Référence : DARES. Rapport d’études, La discrimination à l’embauche selon le sexe, mars 20228.
Cette étude s’appuie sur l’envoi de candidatures fictives des deux sexes en réponse à des offres d’emploi réelles. Leur succès en est mesuré à partir des taux de rappel. Résultats :
– en moyenne : femmes et hommes sont aussi souvent contactés par les employeurs (sauf les femmes d’origine supposée maghrébine, qui le sont davantage)
– dans le détail : les hommes sont moins favorisés pour les métiers de cadres, et plus favorisés pour les métiers les moins qualifiés. Les femmes sont favorisées en particulier dans les métiers masculinisés.
– la présence sur le CV d’indications de présence d’enfants, de situation conjugale ou d’existence de périodes d’inactivité n’induit pas de discrimination des candidatures féminines.
Ceci dit, la discrimination à l’embauche étant illégale, elle est le plus souvent organisée par les directions d’entreprises de manière discrète et implicite. De ce fait, elle ne peut être connue que par les aveux ponctuels de leurs dirigeants. Tel celui d’ Anne Lauverjon, présidente d’Areva. « A compétences égales, eh bien désolé, on choisira la femme, ou bien on choisira la personne venant d’autre chose que le mâle blanc, pour être clair »9. Ou telle l’annonce de France 3 cherchant à embaucher un présentateur pour le Soir 3, « plutôt de sexe féminin »10.
.
6. L’existence d’une discrimination salariale au profit des hommes n’a jamais été démontrée
Référence : Ecart de salaire entre femmes et hommes en 2023. INSEE Focus, 04/03/202511
Les idéologues misandres soutiennent, sans tenir compte de toutes les données du problème, la thèse selon laquelle les salaires féminins seraient inférieurs aux salaires masculins, ce qui traduirait une discrimination systémique. Ils ne prennent pas en compte les données suivantes :
– dans le secteur public, aucune discrimination salariale n’est possible. Or ce secteur est important : en 2024, il représentait 5 millions de salariés soit 21,1% de la population active. Parmi les cadres de ce secteur, 50,4% sont des femmes12.
– dans le secteur privé, toutes situations confondues, le revenu salarial moyen des femmes est inférieur de 22,2% à celui des hommes. Explication : au plan du temps, les femmes travaillent moins que les hommes, que ce soit à cause des arrêts de travail (en particulier du fait des maternités) ou du fait que leur nombre d’heures de travail est inférieur (en particulier temps partiel choisi ou subi).
– à temps de travail égal, l’écart se réduit à 14,2%. Cet écart diminue régulièrement : en 1995, il était de 22,1%. Explication : hommes et femmes travaillent dans des secteurs différents. Les femmes privilégient les professions axées sur les relations humaines et le langage, qui sont moins rémunérées.
– à poste comparable, c’est-à-dire avec la même profession exercée pour le même employeur, l’écart se réduit à 3,8%. Dans toutes les enquêtes, il demeure un écart de dimension analogue, lequel pourrait être considéré comme la marque d’une discrimination avérée. Mais tel n’est pas le cas : l’écart n’est pas expliqué (il est d’ailleurs qualifié explicitement d’« inexpliqué »). Il ne démontre rien, sauf l’embarras des enquêteurs, qui se trouvent confrontés à leur propre ignorance, et posent comme explication une discrimination qui demeure une simple hypothèse. Il serait plus honnête de leur part d’admettre qu’ils ne sont pas en mesure de connaître toutes les caractéristiques des postes de travail.
7. La présumée discrimination dans le travail en faveur des hommes n’a donc pas de réalité. Elle est un concept d’inspiration idéologique misandre.
Il existe forcément des cas ponctuels, localisés, de discrimination contre des femmes, ou contre des hommes. Mais il n’existe pas de système organisé de discrimination au profit des hommes.
L’objectif de l’idéologie misandre est d’abaisser et de culpabiliser les hommes. Elle les abaisse dans les divers domaines de la vie familiale et sociale. Dans la vie familiale, ils seraient mauvais conjoints, mauvais pères, insensibles, égoïstes, parasitaires, violents et violeurs. Dans la vie sociale, ils seraient individualistes et avides de pouvoir. L’analyse misandre du travail a pour fonction de compléter et conforter ce tableau négatif : elle les décrit comme solidaires entre eux, dominateurs et discriminateurs.
8. Le GES propose :
Voir dans la Plate-forme de propositions les parties C5 et C6 :
C. Favoriser la libre implication des hommes et des femmes dans la vie sociale
Les choix d’engagement professionnel et politique des personnes ne doivent pas être contraints par des stéréotypes, qu’ils soient anciens ou récents. De même, la recherche d’équilibres nouveaux doit s’effectuer dans le respect des principes républicains, ce qui exclut toute mesure coercitive.
5. Abrogation des lois instaurant une discrimination genrée (lois instaurant des quotas sexués en matière électorale, dans les conseils d’administration des entreprises et autres instances sociales)
6. Campagnes de valorisation de la présence masculine et de recrutement de personnel masculin dans les secteurs suivants :
– enfance, éducation, santé, justice. Dans ces secteurs, en effet, la mixité du personnel favorise la compréhension et la satisfaction des besoins des utilisateurs de chaque sexe. Ainsi, les enfants sont enrichis par la mixité du personnel d’éducation. La Justice familiale est plus équitable si le personnel judiciaire est mixte.
– secrétariat, prêt à porter : de nombreux hommes sont prêts à exercer dans ces secteurs, mais beaucoup d’entre eux sont discriminés à l’embauche.
.
1 Observatoitre des inégalités. L’inégale répartition des tâches domestiques entre les femmes et les hommes. 29 avril 2016 https://www.inegalites.fr/spip.php?page=article&id_article=245&id_groupe=15&id_mot=102&id_rubrique=114
2 François de Singly. De l’injustice ménagère (introduction). Armand Colin, 2007
3 INSEE références. Emploi, chômage, revenus du travail (Evolution de la population active). Edition 2023 https://www.insee.fr/fr/statistiques/7456889?sommaire=7456956
4 DEPP. Panorama statistique des personnels de l’enseignement scolaire 2022-2023 https://www.education.gouv.fr/panorama-statistique-des-personnels-de-l-enseignement-scolaire-2022-2023-379668
5 Les magistrats. Infostat Justice, avril 2018, n° 161
6 Statista. Répartition femmes-hommes des cadres selon le type de poste occupé en France en avril 2021 https://fr.statista.com/statistiques/1294604/repartition-hommes-femmes-cadre-fonction-france/
7 Défenseur des droits. Décision MLD-2015-305 du 3 décembre 2015
8 DARES. Rapport d’études, La discrimination à l’embauche selon le sexe, n°23, mars 2022 https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/discrimination-lembauche-selon-le-sexe-les-enseignements-dun-testing-de-grande-ampleur
9 Anne Lauverjon. France 2, journal du soir, 16 octobre 2009
10 JDD, 12 décembre 2010
11 Ecart de salaire entre femmes et hommes en 2023. INSEE Focus, n°349, 04/03/2025 https://www.insee.fr/fr/statistiques/8381248
12 INSEE. Les cadres : de plus en plus de femmes. Insee Focus, n° 205, 25/09/2020